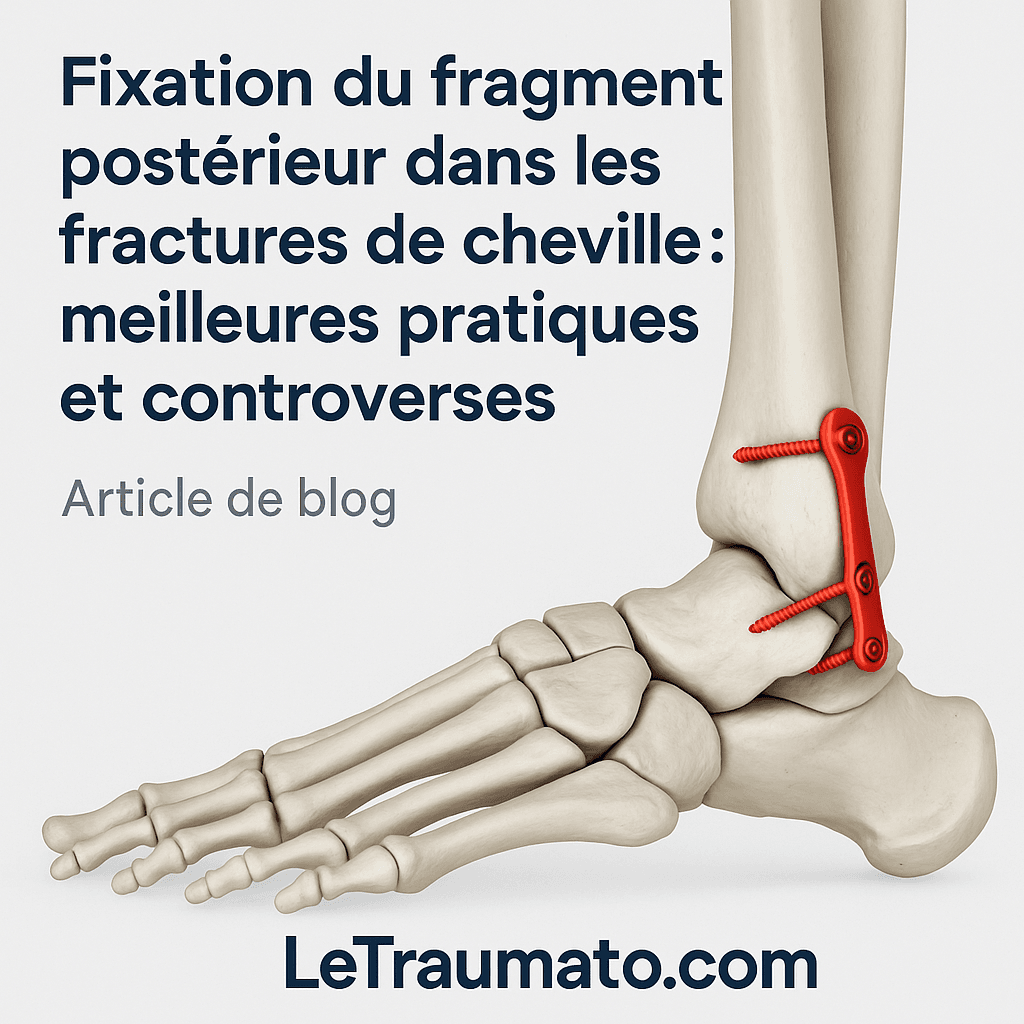Dernière mise à jour : 20/10/2025
Résumé
La malléole postérieure, définie comme la partie posteroinférieure du plafond tibial, est fracturée dans 7 % à 44 % des fractures de cheville. Insérée sur le PITFL (ligament interosseux postérieur), elle joue un rôle clé dans la stabilité de la syndesmose. La question de sa fixation reste débattue : historiquement, on recommandait de fixer tout fragment > 25–30 % de l’articulation ou déplacé > 2 mm. Or, les études récentes montrent que d’autres critères (instabilité syndesmotique, pas articulaire résiduel, enfoncement du plafond, fragments libres) doivent être considérés. De nombreuses données cliniques (essais contrôlés, méta-analyses) soulignent l’importance de la restauration anatomique pour réduire le risque d’arthrose post-traumatique. Si le consensus reste en construction (on observe « une nette tendance à la fixation systématique du fragment postérieur»), les choix techniques varient (vis antéropostérieure, vis postéro-antérieure, plaque postérieure via abord postérolatéral ou postéromédial), avec des avantages et inconvénients propres (stabilité accrue vs risques cutanés, durée opératoire). Cet article pédagogique fait le point sur les meilleures pratiques et controverses récentes, illustré par deux cas cliniques typiques, et donne des pistes de formation pour les internes.
Introduction
La malléole postérieure est l’« apophyse osseuse postérieure du plafond tibial » décrite par Henderson en 1932, formant la marge postéro-inférieure de la surface articulaire tibiale. Elle constitue l’insertion du ligament interosseux postérieur (PITFL) et contribue donc à la stabilité sagittale de la cheville. Dans les fractures de cheville, elle est impliquée dans 7 % à 44 % des cas (fractures trimaléolaires ou bien bicompartimentales avec atteinte postérieure). Un fragment postérieur non réduit crée un écart articulaire (« step-off ») ou une subluxation postérieure du talus, exposant à long terme à l’arthrose tibio-astragalienne. À mesure que le diagnostic par tomodensitométrie (CT) s’est généralisé, l’intérêt pour ce fragment a augmenté. Historiquement, on retenait comme indications classiques de fixation : fragment > 25–30 % de la surface articulaire et déplacement > 2 mm. Mais ces critères stricts sont aujourd’hui remis en question au profit d’une approche centrée sur la congruence articulaire globale.
Données cliniques actuelles
Le paysage thérapeutique récent est fondé sur plusieurs essais et revues systématiques. Karaismailoğlu et al. (essai randomisé) ont montré qu’un pas articulaire postérieur résiduel > 1 mm était associé à un moins bon pronostic fonctionnel. Shi et al. (RCT sur trimalleolaires avec fragment > 25 %) ont démontré qu’un abord direct postérolatéral (fixation du fragment en premier) donnait une réduction plus anatomique et des scores AOFAS supérieurs qu’un vissage antéropostérieur indirect, sans différence de mobilité ou de douleur. Inversement, Langenhuijsen et al. ont trouvé que, pour tout PMF couvrant > 10 % de la surface articulaire, la clé du succès était la restauration de la congruence; on ne fixerait alors que les fragments restant déplacés après réduction des malléoles latérale et médiale. Verhage et al. ont confirmé que tout « step-off » > 1 mm accroît significativement le risque d’arthrose, indépendamment de la taille initiale du fragment.
Les méta-analyses récentes jettent un éclairage sur les méthodes de fixation. La méta-analyse en réseau de Shih et al. (2024) comparant vis antéropostérieures (AP), vis postéro-antérieures (PA) et plaques en buttress postérieur conclut que la plaque offre les meilleurs résultats radiologiques (moins de faux crochets, arthrose et perte de réduction) alors que le vissage procure généralement de meilleurs résultats fonctionnels et douleur. Les courbes de classement montrent que les vis AP sont associées au meilleur AOFAS et aux moindres complications infectieuses/peronéennes, les vis PA au meilleur résultat sur la douleur (VAS) et la plaque en anti-glissière à la meilleure réduction articulaire post-opératoire. De même, Tu et al. ont rapporté une légère supériorité fonctionnelle des plaques (AOFAS plus élevé, consolidation plus rapide) au prix d’une chirurgie plus longue et hémorragique. Toutefois, une étude prospective récente (Teimouri et al., 32 patients vis vs 32 plaques) n’a pas mis en évidence de différence nette à 6 mois entre les deux techniques sur les scores de douleur ou fonction, illustrant la controverse actuelle.
Par ailleurs, la discussion inclut le concept d’instabilité syndesmalaire. Datta et al. soulignent qu’il existe un consensus clair sur le fait que la fixation du fragment postérieur améliore la stabilité rotatoire globale de la cheville. En pratique, un fragment postérieur significatif est souvent corrigé pour rétablir la longueur de la guêtre tibiofibulaire postérieure et soulager le PITFL. La classification joue un rôle organisationnel : la classification de Haraguchi (type I postérolatéral, II extension médiale, III en coquille) reste utilisée pour décrire la fracture en 2D, tandis que la classification de Bartoníček/Rammelt (4 types, basée sur l’anatomie 3D du fragment) est de plus en plus promue car elle comprend un algorithme thérapeutique. Terstegen et al. concluent que, bien qu’aucune classification ne soit universelle, la classification de Bartoníček/Rammelt a un bon potentiel du fait de sa fiabilité et de sa corrélation pronostique. Enfin, Nasrallah et al. rappellent (2021) qu’« à ce jour, aucun consensus n’existe » sur la prise en charge standard du malléole postérieur dans les fractures trimaléolaires, soulignant la nécessité de décisions individualisées basées sur l’imagerie et la stabilité.
Discussion critique
Bénéfices de la fixation : Le point commun des analyses est que réduire anatomiquement le plafond articulaire améliore la charge et réduit l’arthrose. Datta et al. insistent sur l’importance de la congruence articulaire : plus que la taille du fragment, c’est le pas articulaire final qui dicte les résultats. Les études montrent que fixer le PMF stabilise efficacement la syndesmose, permettant souvent de se passer de vis syndesmalaire complémentaire. Les avantages cliniques rapportés incluent de meilleures amplitudes de mouvements finales (vis AP) et un score de douleur moindre (vis PA). Les plaques postérieures offrent une stabilité mécanique accrue, ce qui se traduit par moins de déplacement secondaire et moins d’arthrose post-opératoire. L’étude de Tu indique qu’au delà de la consolidation plus rapide, les plaques permettent une reprise d’appui plus précoce et une sédation de la douleur postopératoire.
Risques et complications : Le revers de la médaille tient aux contraintes chirurgicales. Les abords postérieurs peuvent majorer les lésions cutanées et nerveuses (sural), surtout en position couchée. Heyes et al. (revue sur l’abord postérolatéral) rapportent un taux d’infection superficielle d’environ 4,5 % et un taux similaire de dysesthésies sur le nerf sural. L’enlèvement ultérieur du matériel est nécessaire dans ~14 % des cas (plaques ou vis palpables), mais Heyes note qu’aucune de ces réinterventions n’a concerné le fragment postérieur lui-même. Dans l’étude de Teimouri, le groupe vis a eu 1 complication nerveuse et 4 infections (superficielles + profondes) contre respectivement 2 et 2 dans le groupe plaques. Les plaques impliquent habituellement une incision plus large et parfois une courte position sur le ventre; les vis antéropostérieures (AP) peuvent se faire en décubitus dorsal plus rapidement, mais risquent d’arracher un petit fragment si mal placées. Shih et al. notent que les vis AP présentent le taux d’infection et de lésion nerveuse le plus faible, tandis que les plaques, bien que meilleures radiologiquement, exigent des temps opératoires plus longs et plus de saignement.
Variations techniques : Trois grands paramètres techniques varient : la voie d’abord, le type d’ostéosynthèse, et la séquence opératoire.
- Voie d’abord : Traditionnellement, la réduction indirecte antéropostérieure se faisait avant de fixer la fibula. Aujourd’hui, les abords postérieurs sont privilégiés. L’abord postérolatéral permet d’exposer directement le fragment latéral et de combiner la fixation du péroné par la même incision. L’abord postéromédial cible surtout les fragments avec extension médiale (type Haraguchi II) et permet de traiter la malléole médiale associée via une seule voie. L’approche dorsale « lazy lateral » (paumes du patient vers l’extérieur) ou la biposition (prone + dorsal en deux temps) sont décrites pour améliorer la visibilité. L’arthroscopie reste expérimentale pour évaluer la congruence, mais n’est pas couramment utilisée en pratique de base.
- Matériel de fixation : Les vis transtibiales peuvent être orientées AP (décubitus dorsal) ou PA (prone). Les vis AP sont simples et rapides, mais moins adaptées aux petits fragments; les vis PA permettent souvent une réduction plus précise. Les plaques en « buttress » postérieures (petite plaque T ou plaque spécifique antiglisse) sont idéales pour les fragments larges ou comminutifs. Leur contre-appui mécanique empêche le glissement du fragment pendant la charge. Enfin, on peut parfois mettre un clou rush pour la fibula une fois le PM stabilisé.
- Séquence opératoire : Plusieurs équipes fixent d’abord le fragment postérieur (cas des fixations postérieures directes mentionnées), estimant que la plaque fibulaire risquerait de gêner la réduction. D’autres commencent par la malléole interne, puis le PM, enfin la latérale. L’essentiel est de vérifier à la scopie final que le pas de la malléole postérieure est < 1 mm avant de refermer. Un consensus transversal met en garde contre l’utilisation exclusive de fragments postérieurs non déplacés pour diagnostiquer ou guérir la lésion syndesmalaire (CT est plus fiable).
Exemples cliniques
Cas 1 (jeune patient polytraumatisé) : Homme de 42 ans, chute de hauteur, trimalleolaire bimalléole + gros fragment postérieur. Le scanner montre un grand fragment postérolatéral couvrant ~35 % de la surface articulaire, avec légère diastasis tibiofibulaire. Après fixation de la malléole médiale, la malléole latérale par plaque sus-péronière, le fragment postérieur a été réduit sous scopie et stabilisé par une plaque antiglissière postérolatérale en position ventrale. L’indication retenue était la taille importante du fragment, l’instabilité révélée à la manœuvre de Cotton (soulèvement tibial), et la possibilité d’éliminer l’écart syndesmalaire en fixant le PITFL. Les suites ont été simples, avec reprise d’appui protégé à 6 semaines et score AOFAS excellent à 6 mois. Cette prise en charge illustre une situation typique où la fixation postérieure systématique est justifiée (forte instabilité, fragment large, objectif congruence parfaite).
Cas 2 (patient âgé) : Femme de 78 ans, entorse violente de la cheville en supination-externe, radiographie de face/laterale révélant une fracture bimalléolaire avec petit fragment postérieur non déplacé (< 20 % de la surface), épaississement du ligament deltoïde. Le scanner a confirmé un fragment postérieur minime sans comminution, et aucun espace syndesmotique supplémentaire après réduction de la malléole fibulaire. L’équipe a opté pour la fixat° des malléoles médiale et latérale uniquement, sans fixation spécifique du fragment postérieur. Les raisons étaient l’âge avancé, la taille modeste du fragment, et le risque de chirurgie plus lourde (position ventrale longue) face à un fragment non déplacé. Un contrôle par arthroscopie non invasif a été envisagé post-op pour vérifier la congruence articulaire. À 3 mois, la fonction était satisfaisante, avec néanmoins une légère perte dorsiflexion (en lien possible avec la coaptation ligamentaire). Ce cas montre le compromis parfois nécessaire chez le sujet âgé : le traitement n’est pas mécanique mais fonctionnel, on cherche à minimiser la chirurgie tout en acceptant un petit décalage si stable. Les internes doivent comprendre que la décision de ne pas fixer un petit fragment peut être raisonnable, à condition d’avoir reconfirmé l’intégrité syndesmotique et une bonne congruence radiologique sous scopie finale.
Implications pour la formation des internes
- Imagerie pré-opératoire : insister sur l’importance du scanner en entorse et fracture de cheville instable. Un PMF peut échapper au cliché standard, ou masquer l’étendue des dégâts. Enseigner la lecture en reconstructions axiales et coronales pour mesurer précisément le pourcentage de surface articulaire engagé et repérer tout épanchement articulaire ou fragment libre.
- Critères de décision : souligner que le choix ne se réduit plus à « > 25 % fixe, sinon non ». Expliquer les risques de l’arthrose (Verhage) et le gain de stabilité (Datta) qui militent souvent pour la fixation. Toutefois, laisser le raisonnement chez l’interne intégrant les contextes (âge, comorbidités, trauma open vs closed) pour affiner la stratégie.
- Technique chirurgicale : familiariser avec les différents abord postérieurs – posterolateral, posteromedial, ou position ventrale – en démonstration. Montrer la voie postérolatérale dans un cas type (exemple vidéo chirurgicale si possible) et insister sur la protection du sural nerve. Détailler la technique de vissage AP sous scopie, et celle de la plaque anti-glissière (placement parallèle au plafond). Rappeler les conseils pratiques : vis de 3,5 mm ou 4 mm pré-percées, contrôle conjoinctif scannographique après réduction, etc.
- Gestion des complications : aborder la prévention des complications cutanées (éviter sur-courir, angle d’incision, diaphyse de jambe viable). Montrer des cas d’infection et discuter du protocole AB prophylactique. Traiter de la prise en charge d’un matériel déréglé (arthrodèse vs reprise chirurgicale) pour conclure le module technique.
- Suivi post-opératoire : insister sur la nécessité d’un contrôle clinique de la stabilité, et d’un contrôle radiologique à 6–12 semaines (consolidation, position du fragment). Encourager la rééducation précoce (mobilisation passive en extension, charges partielles à 6 semaines) comme l’étudie le protocole FAME (clinical trial en cours sur la marche précoce).
Conclusion
La fixation du fragment postérieur dans les fractures de cheville est désormais considérée comme un facteur clé de bonne réduction et de stabilité, et tend à être systématique sauf exception. Cependant, le choix opératoire reste personnalisé. Les indications classiques basées sur la taille du fragment sont complétées par des critères d’instabilité syndesmalaire ou de congruence articulaire. Les méthodes diffèrent (vis AP/PA vs plaque), chacune avec ses avantages : les plaques postérieures offrent une réduction plus nette et réduisent l’arthrose radiologique, les vis antéro-postérieures peuvent donner de meilleurs résultats fonctionnels à court terme. Il est crucial de peser les bénéfices (stabilité accrue, meilleure congruence) contre les risques (complications cutanées, durée chirurgicale) dans une approche globale. L’enjeu pédagogique est de préparer l’interne à cette décision complexe, en lui transmettant les points clés (imagerie, indications, techniques) pour qu’il devienne un praticien avisé, capable de justifier sa stratégie à la lumière des données récentes.
Bibliographie
- Datta M. et al. (2024), Cureus (10.7759/cureus.72081)
- Shih C.-A. et al. (2024), Bone Jt Open (DOI:10.1302/2633-1462.53.BJO-2023-0133.R1)
- Teimouri M. et al. (2024), Int J Burn Trauma (DOI:10.62347/YWLY8048)
- Fernández-Rojas E. et al. (2022), Rev Esp Cir Ortop Traumatol (DOI:10.1016/j.recot.2022.10.019)
- Nasrallah K. et al. (2021), Orthop Rev (Pavia) (DOI:10.4081/or.2021.8784)
- Terstegen J. et al. (2022), J Foot Ankle Surg (PMC10293398)
- Heyes G.J. et al. (2023), Foot Ankle Spec (DOI:10.1177/19386400211009366)