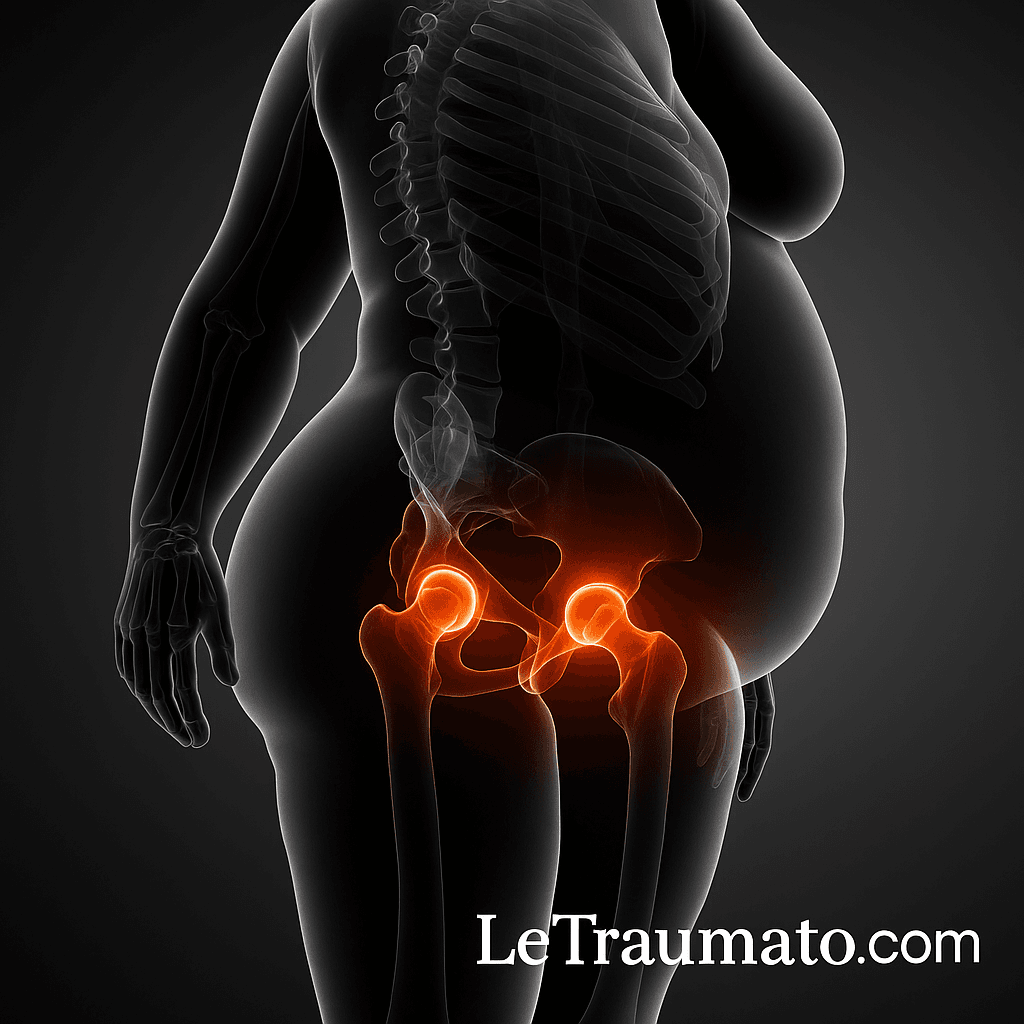Résumé
Cet article examine l’impact d’un programme de perte de poids préopératoire à l’aide d’une téléconsultation diététique et d’une application mobile chez les patients obèses (IMC 40–47 kg/m²) candidats à une prothèse totale de hanche ou de genou. Un essai clinique multicentrique (60 patients) comparant 12 semaines de suivi diététique à distance (app + vidéo) au suivi habituel a montré une perte de poids moyenne modeste dans le groupe intervention (-4,1 kg vs -2,1 kg), sans différence statistiquement significative*. Dans l’ensemble, 83 % des patients ont trouvé les appels vidéo utiles, et aucun bénéfice fonctionnel (scores HOOS, KOOS) ou diminution des complications n’a été mis en évidence*. L’intervention s’est avérée faisable et bien acceptée, suggérant que les solutions numériques peuvent combler des lacunes d’accès à la prise en charge de l’obésité avant chirurgie*. Le bilan pédagogique souligne l’importance de former les internes en orthopédie à l’éducation thérapeutique nutritionnelle, à l’e-santé et à la prise en charge multidisciplinaire du patient obèse.
Introduction
L’obésité représente un défi majeur de santé publique qui alourdit le pronostic de l’arthrose et de l’arthroplastie. En effet, l’obésité multiplie par quatre le risque de gonarthrose et est associée à un risque jusqu’à 9 à 33 fois plus élevé de prothèse de hanche ou de genou pour les patients sévèrement obèses*. De plus, chez les patients obèses, la chirurgie articulaire est plus complexe et les complications postopératoires plus fréquentes: en prothèse de genou (TKA) l’obésité augmente le temps opératoire, la durée d’hospitalisation et les risques d’infection, de révision et de malposition de l’implant*, tandis qu’en prothèse de hanche (THA) elle accroît les complications de cicatrisation, d’infection profonde, le risque de luxation et d’embolie pulmonaire*. Face à ces enjeux, les recommandations de prise en charge de l’arthrose insistent sur un accompagnement à la perte de poids. Par exemple, les guidelines NICE britanniques préconisent de proposer systématiquement des interventions de perte de poids pour les patients en surpoids ou obèses souffrant d’arthrose*. Aux États-Unis, l’AAHKS recommande explicitement une réduction pondérale pour les patients avec IMC ≥ 40 avant prothèse de genou*. À l’inverse, une revue belge récente rappelle qu’« aucune intervention, y compris la prothèse de genou, ne devrait [être] refusée quel que soit le BMI »*, soulignant l’importance d’une prise en charge centrée sur le patient plutôt que sur un seuil arbitraire. Dans cette perspective, les programmes de rétablissement amélioré (RAAC/ERAS) considèrent l’optimisation préopératoire (arrêt du tabac, exercice, nutrition) comme essentielle pour accélérer la convalescence et réduire les risques opératoires.
Les complications liées à l’obésité incluent notamment :
- TKA (genou) : augmentation du temps opératoire, de la durée d’hospitalisation, et risque accru d’infections, de reprises chirurgicales et de mauvaise position des implants*.
- THA (hanche) : majoration des complications de cicatrisation, infections profondes, luxations de la prothèse et embolies pulmonaires*.
Les professionnels de santé s’interrogent donc sur les meilleures stratégies pour aider ces patients à maigrir avant chirurgie. Le programme ERAS recommande un suivi diététique et un état nutritionnel optimisé, mais en pratique les structures d’accompagnement sont variables. L’étude récente de Seward et al. (JBJS 2025) évalue l’apport concret d’une intervention diététique à distance couplée à une application mobile pour améliorer la perte de poids préopératoire chez des patients obèses candidats à une arthroplastie*.
Données cliniques de l’essai RCT multicentrique (JBJS 2025)
Cet essai contrôlé randomisé multicentrique a inclus 60 patients adultes (IMC 40–47 kg/m², âge moyen 61 ans, 67 % de femmes) programmés pour une PTH ou PTG de première intention*. Les patients ont été assignés soit à une prise en charge standard (groupe témoin, n=29), soit à une intervention de 12 semaines comprenant des consultations vidéo avec un diététicien et l’utilisation d’une application mobile de suivi alimentaire (groupe intervention, n=31)*. Les mesures (poids, IMC, scores fonctionnels HOOS/KOOS/LEAS, complications) ont été relevées au départ et à 12 semaines, avec 87 % de suivi.
Dans le groupe intervention, les patients ont perdu en moyenne 4,1 kg sur 12 semaines, contre 2,1 kg dans le groupe contrôle, soit une réduction d’IMC moyenne de -1,4 vs -0,9 kg/m² (toutes les différences étaient non significatives, p=0,22 et p=0,36)*. Un plus grand nombre de patients du groupe diététicien ont franchi le seuil de BMI < 40 kg/m² préopératoire (OR = 1,9, p=0,44), bien que cette tendance ne soit pas statistiquement significative*. Aucune différence notable n’a été observée dans l’évolution des scores fonctionnels (HOOS, KOOS, LEAS) entre les deux groupes*. Le taux de complications postopératoires (tehnotour, thrombose, fracture, réintervention, etc.) était similaire entre les groupes*. Notamment, les auteurs rapportent qu’à la base seuls 11 % des patients avaient vu un diététicien dans les 3 mois précédant la chirurgie, ce qui illustre une certaine sous-exploitation de cette ressource. En outre, 83 % des patients ayant bénéficié du programme à distance ont jugé utile les appels vidéo avec le diététicien*. Ces résultats indiquent que l’intervention est faisable et appréciée, même si l’effet sur le poids est modeste.
Exemple clinique fictif : M. Dupond, 68 ans, IMC 42, se prépare à une prothèse totale de hanche pour coxarthrose sévère. Il participe à un programme de 12 semaines où il consulte un diététicien en visio et enregistre son alimentation sur une application mobile. Il parvient à perdre environ 5 kg, s’approchant d’un IMC de 40. Bien qu’il ne réalise pas d’amaigrissement spectaculaire, cette démarche le motive et lui permet d’améliorer légèrement sa condition métabolique avant la chirurgie.
Discussion critique
Les données de cet essai s’inscrivent dans la littérature existante sur la perte de poids préopératoire. D’une part, la perte moyenne observée (environ 2–4 kg en 3 mois) est du même ordre que celle rapportée par des interventions de santé mobile (5 kg environ sur 3–6 mois)*. D’autre part, seuls ~7 % des patients sévèrement obèses réussissent spontanément à franchir le seuil de BMI<40 via des modifications du mode de vie, comme montré par Seward & Chen*. Il est également notable que Kim et al. ont rapporté qu’une perte de poids préopératoire ≥ 5 % chez les patients en PTG était paradoxalement associée à une augmentation du risque de reprise (p=0,030)*, suggérant que la relation poids-risque est complexe et dépend de facteurs individuels.
Les forces de l’étude résident dans son design prospectif multicentrique et son approche pragmatique (patients en conditions réelles). Toutefois, plusieurs limites doivent être soulignées. L’effectif est modeste (n=60), ce qui limite la puissance statistique pour détecter de petites différences, notamment sur les scores fonctionnels et la fréquence des complications rares. La durée de suivi de l’intervention (12 semaines) a produit un gain de poids modeste ; une intervention plus longue ou plus intensive (par exemple, intégrant un soutien médicamenteux ou une chirurgie bariatrique) pourrait être nécessaire pour obtenir un effet cliniquement significatif sur l’IMC**. De plus, le groupe contrôle n’a pas reçu d’intervention active (standard de soins), ce qui rend difficile d’évaluer l’effet « placebo » d’un suivi régulier. Enfin, la variabilité entre centres (diététiciens différents, adhérence aux appels) n’est pas détaillée, mais pourrait influencer les résultats.
Dans l’ensemble, cette étude confirme la faisabilité d’un suivi diététique à distance dans le parcours de soins avant arthroplastie. Elle montre que les patients apprécient ce soutien et que les outils numériques peuvent combler le manque d’accès aux conseils diététiques*. En pratique, ces résultats suggèrent d’intégrer systématiquement un accompagnement nutritionnel dans les protocoles ERAS pour prothèse (avant l’intervention). Il conviendra toutefois d’associer, si nécessaire, d’autres modalités (prise en charge bariatrique, médicaments anti-obésité) pour optimiser la perte de poids. Par ailleurs, les praticiens doivent rester vigilants sur le risque de ne pas retarder indûment la chirurgie en attendant une perte de poids qui peut être difficile à obtenir dans ce contexte.
Implications pédagogiques pour la formation des internes
La préparation préopératoire du patient obèse fait appel à de multiples compétences transversales qu’il est essentiel de développer chez les internes en orthopédie :
- Communication et éducation thérapeutique : savoir motiver le patient obèse, expliquer les bénéfices attendus d’une perte de poids (réduction du risque infectieux, meilleure rééducation), et utiliser un langage adapté. Par exemple, une étude de cas pédagogique peut présenter un patient obèse de 55 ans devant une PTG, et demander à l’interne de concevoir un plan nutritionnel et d’activité à discuter avec ce patient.
- Compétences en e-santé : maîtrise des outils numériques (applications mobiles de suivi diététique, téléconsultation). L’internat devra inclure des exercices d’utilisation de ces technologies et la lecture d’études telles que celle de Seward et al. pour sensibiliser les futurs chirurgiens aux possibilités de télémédecine.
- Travail interprofessionnel : collaboration avec les diététiciens, les cardiologues, le personnel d’anesthésie et de rééducation. Les internes doivent connaître le parcours du patient obèse, depuis son médecin traitant (orientation vers nutritionniste) jusqu’au bloc opératoire. Des ateliers interdisciplinaires (chirurgien, diététicien, anesthésiste) peuvent être mis en place pour simuler la prise en charge globale du patient.
- Approche centrée patient : encourager le shared decision-making. Les internes doivent expliquer que, même si l’arthroplastie chez un obèse comporte plus de risque, « aucun seuil d’IMC ne doit automatiquement conduire à refuser l’intervention »*. Comme le préconise Blankstein, un abord multidisciplinaire centré sur le patient est recommandé*. Par exemple, un résident peut être évalué sur sa capacité à expliquer à un patient que la chirurgie est possible malgré un IMC élevé, tout en proposant un plan de gestion de poids.
Ces compétences non techniques (communication, collaboration, utilisation de l’outil numérique) complètent la formation chirurgicale classique. Elles répondent aux exigences actuelles des parcours RAAC et des recommandations d’éducation thérapeutique pour les maladies chroniques.
Conclusion
La prise en charge de l’obésité avant arthroplastie est une étape critique qui nécessite un accompagnement structuré. L’essai multicentrique de Seward et al. (JBJS 2025) démontre qu’un programme de diététicien à distance couplé à une application mobile est réalisable et bien accepté par les patients sévèrement obèses, permettant une perte de poids modeste préopératoire**. Bien que cette perte ne soit pas statistiquement significative, l’étude souligne l’intérêt des solutions numériques pour améliorer l’accès aux conseils nutritionnels. Sur le plan pratique, ces résultats militent pour l’intégration de telles interventions dans les protocoles ERAS et pour une approche éducative pluridisciplinaire. Poursuivre les recherches sur des stratégies plus intensives (programmes prolongés, thérapeutiques pharmacologiques) sera essentiel pour atteindre une perte de poids ayant un réel impact clinique. Par ailleurs, la formation des jeunes orthopédistes doit évoluer pour inclure ces nouveaux outils et compétences : éducation nutritionnelle, utilisation d’applications de santé et collaboration étroite avec les diététiciens sont désormais indispensables dans le parcours de soins du patient obèse.
Bibliographie
Bocankova B, Meirlaen S, Thienpont E. Gonarthrose et le patient obèse: recommandations pratiques. Louvain Médical. Mars 2023. Disponible sur: https://www.louvainmedical.be/fr/article/gonarthrose-et-le-patient-obese-recommandations-pratiques:contentReference[oaicite:40]{index=40}.
Seward MW, Liimakka AP, Jamison MP, Zhu L, Chen AF, et al. Preoperative Weight Loss Using a Remote Dietitian and a Mobile Application: A Multicenter Randomized Controlled Trial. J Bone Joint Surg Am. 2025. DOI: 10.2106/JBJS.24.00838**.
Seward MW, Chen AF, et al. Obesity, preoperative weight loss, and telemedicine before total joint arthroplasty: a review. Arthroplasty (Beijing). 2022;4(1):2. DOI: 10.1186/s42836-021-00102-7**.
Blankstein MW, Browne JA, Sonn KA, Ashkenazi I, Schwarzkopf R. Go Big or Go Home: Obesity and Total Joint Arthroplasty. J Arthroplasty. 2023 Oct;38(10):1928-1937. DOI: 10.1016/j.arth.2023.07.001**.
McLaughlin J, Elsey J, Kipping R, Owen-Smith A, Ong BN, Oliver S, et al. Access to hip and knee arthroplasty in England: commissioners’ policies for body mass index and smoking status…. BMC Health Serv Res. 2023;23:77. DOI: 10.1186/s12913-022-08999-9**.
Kim BI, Cochrane NH, O’Donnell JA, Wu M, Wellman SS, Ryan S, Seyler TM. Preoperative Weight Loss and Postoperative Weight Gain Independently Increase Risk for Revision After Primary Total Knee Arthroplasty. J Arthroplasty. 2022;37(4):674-682. DOI: 10.1016/j.arth.2021.12.003**.